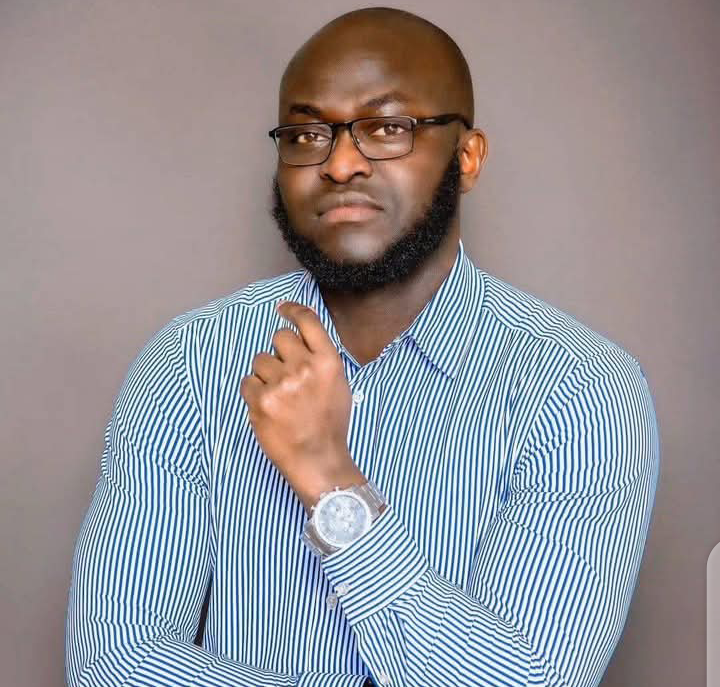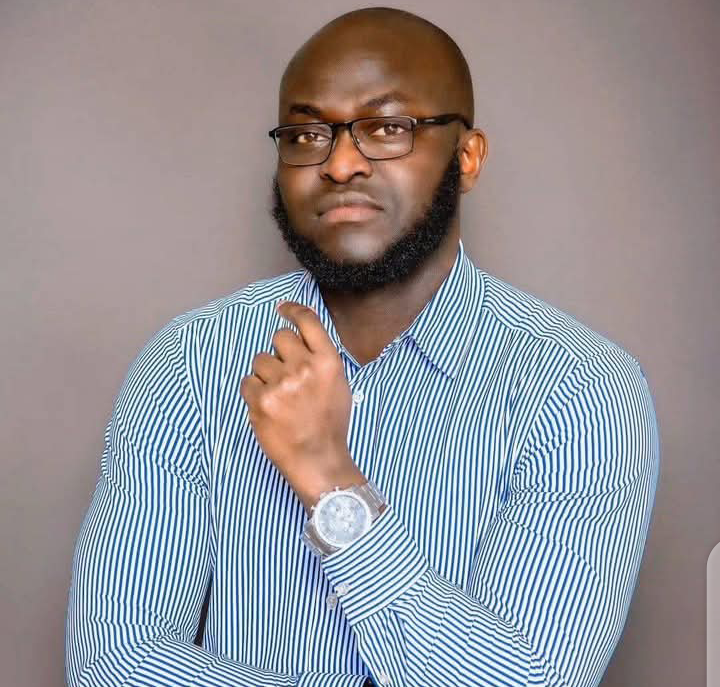La France remet officiellement la base militaire de Ouakam aux autorités sénégalaises, mettant un terme à plus de 500 ans d’histoire militaire française sur le sol sénégalais. Cette décision découle d’une volonté politique affirmée par le Président Bassirou Diomaye Faye qui, dès novembre 2024, déclarait: «J’ai instruit le Ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025.». Cette rupture avec l’héritage colonial répond à une promesse de campagne: recouvrer une souveraineté nationale totale, tant symbolique que stratégique.
Les origines historiques de la présence militaire française au Sénégal remonte au début des temps modernes. En effet, l’installation militaire française au Sénégal ne peut être comprise sans revenir à la reconfiguration géopolitique du XVe siècle. En 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans ferme les routes terrestres vers l’Orient aux puissances européennes. En réponse, ces dernières se tournent vers l’Atlantique, ouvrant une ère d’exploration maritime avec l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492 et la découverte de nouvelles routes commerciales en Afrique et en Asie par les Portugais et les Espagnols. Dès 1569, les Français établissent un comptoir à Saint-Louis, puis s’installent à Gorée, deux bases essentielles au commerce triangulaire. Le dispositif militaire français s’implante pour protéger les intérêts commerciaux, mais aussi pour concurrencer d’autres puissances européennes, notamment les Britanniques, avec lesquels la France alterne conquêtes et pertes de territoires, notamment durant la guerre de Sept Ans (1756-1763).
Cependant, l’armée française passe du commerce à la conquête par la militarisation de la colonisation. Autrement dit, avec la révolution industrielle du XIXe siècle, la France colonialiste cherche à sécuriser ses approvisionnements en matières premières. À partir de 1820, Saint-Louis devient une base militaire stratégique. La conquête militaire prend un tournant décisif avec l’arrivée du général Louis Faidherbe (1854-1865), nommé gouverneur du Sénégal. Il développe une infrastructure militaire (forts, routes, garnisons) et mène des campagnes violentes contre les royaumes sénégambiens. Des villages entiers sont brûlés par l’armée française surtout dans le Walo, le Djolof et le Cayor en faisant des milliers de victimes. Ces actions, qualifiées par certains députés français comme des crimes de masse, sont dénoncées notamment par Georges Clémenceau: « La conquête est toujours l’asservissement d’un peuple et toujours injuste » (30 juillet 1885). Mais, Jules Ferry (dont son nom porte toujours une rue à Dakar) défend la colonisation au nom d’une prétendue mission civilisatrice, justifiant l’usage de la force pour sécuriser les routes commerciales notamment le fleuve Sénégal et étendre l’influence française vers l’intérieur du continent.
La consolidation de la domination française passe par la création, en 1857, des Tirailleurs sénégalais, un corps de soldats africains utilisé dans toutes les campagnes coloniales françaises, puis dans les deux guerres mondiales. Après la défaite de 1870 contre la Prusse, le projet de « force noire », promu par Charles Mangin en 1910, ambitionne de combler le déficit démographique français face à l’Allemagne par un recrutement massif de troupes africaines. En revanche, cette mobilisation prend des allures de répression. Avec le concours de Blaise Diagne, commissaire général au recrutement en 1914, l’armée française organise des rafles et massacres dans les villages réfractaires, accentuant la brutalité du système colonial pour un recrutement forcé.
Dakar devient le carrefour stratégique de l’Empire français. En effet, le Sénégal prend un rôle stratégique au sein de l’empire colonial français: Dakar devient la capitale de l’Afrique occidentale française (AOF) en 1902. Sa base navale devient un pivot essentiel de la marine française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dakar, alors fidèle au régime de Vichy, est la cible d’une tentative de prise par les forces anglo-gaullistes en septembre 1940. À la fin du conflit, les Tirailleurs sénégalais, démobilisés, sont rassemblés au camp de Thiaroye. Lorsqu’ils revendiquent leur solde, ils sont massacrés par l’armée française, en décembre 1944. Cet épisode tragique reste gravé dans la mémoire collective sénégalaise.
La présence militaire française devient une coopération militaire à l’indépendance voire la continuité postcoloniale. Après l’indépendance du Sénégal en 1960, la France et le Sénégal signent des accords de coopération militaire. Ceux-ci permettent la formation de l’armée sénégalaise, son équipement, et le maintien de bases militaires françaises stratégiques, comme le camp Geille à Ouakam, ou l’escale aérienne militaire de l’aéroport Léopold Sédar Senghor à Dakar. Cette présence est régulièrement justifiée par la formation des militaires africains et plus récemment par la lutte contre le terrorisme au Sahel. Toutefois, l’inefficacité de cette présence face aux menaces régionales, combinée aux critiques d’ingérence militaire dans les affaires africaines par l’implication dans les coups d’Etat militaires, ont ravivé les demandes de retrait.
C’est dans ce contexte que le Président Bassirou Diomaye Faye annonce, le 28 novembre 2024, que la présence de bases étrangères est incompatible avec la souveraineté nationale. Cette déclaration survient à l’occasion de la commémoration du massacre de Thiaroye: « Le Sénégal est un pays indépendant, c’est un pays souverain, et la souveraineté ne s’accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. » Ainsi, ce jeudi 17 juillet 2025, le Sénégal tourne la page de plus de 60 ans de présence militaire française post-indépendance, et de plusieurs siècles d’influence coloniale. Les bases françaises de Dakar sont remises à l’État sénégalais. Parallèlement, le Sénégal diversifie ses partenariats stratégiques. La coopération militaire avec la Chine s’inscrit dans cette volonté de redéfinir les alliances du pays en fonction des enjeux géopolitiques contemporains.
En somme, la présence militaire française au Sénégal n’est pas seulement une trace du passé colonial: elle est le produit d’une histoire complexe faite de conquêtes, de répression, de stratégies économiques et de résistances pour servir les intérêtsstratégiques et vitaux de la France. Le retrait de ces troupes en 2025 symbolise la fin d’une époque et marque la volonté du Sénégal de reprendre pleinement le contrôle de sa souveraineté.
Maodo Ba Doba
Historien militaire contemporain,
Professeur en Études stratégiques de défense et politiques de sécurité.